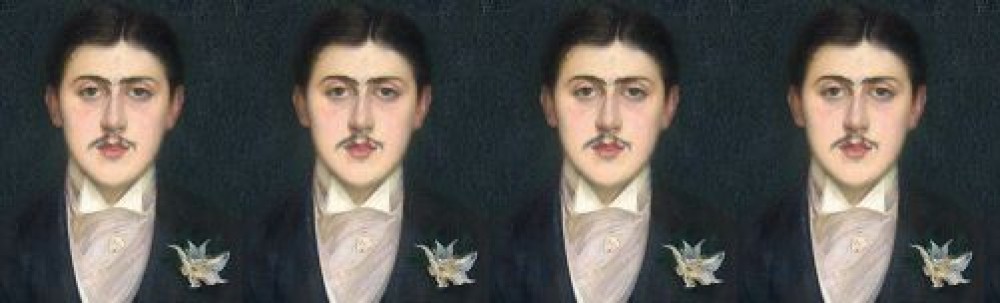Gaston Gallimard (1881 – 1975)
Editeur, patron de presse
.
Un excellent « portrait » de Marcel Proust que celui brossé par Gaston Gallimard dans l’Hommage.
Il a rencontré Marcel Proust dans des conditions très particulières, puisque celui-ci, faute de communications ferroviaires où automobiles, venait de franchir à pied les dix-sept kilomètres qui séparent Cabourg de Bénerville pour le rencontrer.
Tous les souvenirs qu’on a de Marcel Proust peuvent être évoqués par un seul. Une image complète se résume en un trait. Tout son caractère dans un geste, dans une parole. Il me semble que si nous savions appliquer aux anecdotes qui le concernent l’esprit d’analyse qu’il a apporté à la peinture de ses personnages, nous saurions le retrouver tout entier dans la plus fugitive image que garde de lui notre mémoire. Aussi, n’ai-je jamais oublié notre première rencontre ? Elle est restée le point autour duquel sont venues par la suite se grouper toutes mes impressions, et c’est le souvenir que j’en garde, que je dois creuser si je veux ressaisir le profond visage de notre ami.
C’est à Bénerville que je rencontrai pour la première fois Marcel Proust, il y a une vingtaine d’années. Je sortais avec R.G. de la villa qu’il avait louée cet été au bord de la route de Villers, lorsque je vis venir à nous un homme d’aspect incongru et charmant. Marcel Proust arrivait à pied de Cabourg, exprès pour inviter mon ami à dîner au Grand Hôtel où il séjournait. J’ignorais alors jusqu’à son nom. Mais je fus frappé de l’extrême tendresse de son regard et aujourd’hui encore, je le revois tel qu’il m’apparut avec ses vêtements noirs étriqués et mal boutonnés, sa longue cape doublée de velours, son col droit empesé, son chapeau de paille défraîchi trop petit, qu’il portait très en avant sur le front, ses épaules hautes, ses cheveux épais et drus, ses escarpins vernis couverts de poussière. Cet habillement pouvait être ridicule sous le soleil : il ne manquait pas pourtant d’une certaine grâce touchante. Une certaine élégance s’en dégageait et aussi une grande indifférence à toute élégance. Il y avait nulle extravagance de sa part à avoir entrepris cette longue course à pied. Il n’y avait à cette époque aucun autre moyen pratique de franchir les dix-sept kilomètres qui séparaient Cabourg de Bénerville. Mais cet effort qu’il dût faire et dont la fatigue se lisait sur son visage, attestait bien sa « gentillesse ». Il nous conta sa route avec une malice exquise, sans se douter que ce voyage, par cette chaleur, était une grande preuve d’amitié. Il s’était à plusieurs reprises arrêté dans différentes auberges pour y boire du café et reprendre des forces. Tout ceci fut dit avec simplicité, et je fus tout de suite séduit. Avec la divination qu’on lui connaît, il comprit très vite que je souhaitais, avec une impatience de jeunes hommes, qu’il m’invitât. Il ne manqua pas de le faire avec une politesse, une insistance si délicates qu’elles ne me surprirent même pas, bien que venant d’un homme plus âgé que moi. Je le répète, ce costume de ville montrait bien que, pensant à son ami, il avait dû se décider brusquement à ce voyage, et la chaleur et le soleil ne l’avaient pas arrêté. Il n’avait pas pu résister à son désir amical. Sans doute l’attrait que je me sentis pour lui date-t-il de cette minute. Il ne pouvait être pour moi rien d’autre qu’un homme fatigué et pourtant je ne cessais pas de le considérer avec une attention minutieuse. Sur ces entrefaites L. de M., la maîtresse de R.G., nous avait rejoints. Marcel sentit de suite qu’une discussion assez vive avait eu lieu entre les jeunes gens. Mais il ne parut pas l’avoir remarqué ; et je vois encore de quelle façon délicate il posa la main sur la nuque de L., la flattant comme un jeune poulain, mais aussi énumérant avec taquinerie et un air bonassement interrogatif tous ces défauts qu’il connaissait bien. Il la gronda sévèrement d’une voix très douce, très mesurée, mais avec une autorité pleine d’ironie et un entêtement qui me surprirent. Il ne revint à son invitation que lorsqu’il fut bien certain que la détente était définitive.
Le dîner devait avoir lieu quelques jours plus tard. Je l’attendais avec une impatience que je ne m’expliquais pas. En entrant dans le hall de l’hôtel, j’étais ému comme si j’allais participer à quelque événement exceptionnel. Marcel Proust nous accueillit avec une courtoisie que je croyais ne plus exister. Arrivés les premiers, il nous donna les noms de chacun de ses convives- M.B.,M.S.. Il nous fit le portrait de chacun, et son l’histoire. Mais surtout, il nous parla longuement du vieux marquis de N. qui devait être des nôtres. Ce personnage semblait intéresser tout particulièrement sa curiosité et sa bonté. Ruiné, abandonné de sa femme et de ses enfants après une existence bien remplie de femmes et de jeux, ataxique, à moitié paralysé, il voguait comme une épave dans cet immense hôtel, moqué du personnel, au milieu de l’indifférence de tous. Marcel Proust l’entourait avec une attention discrète. Ce malheureux infirme ne pouvait marcher que de biais et, commandant mal ces mouvements, devait en quelque sorte fixer sa chaise et s’y jeter pour s’asseoir. Marcel savait, sans que le marquis s’en rendit compte, placer toujours cette chaise de la façon qui pouvait lui faciliter le plus cette opération. Il en fut de même tout le temps du repas où il sut aider tous ces gestes. Mais surtout il ne cessa de porter la conversation sur le terrain où le vieux marquis pouvait retrouver le plus d’existence. Et je puis bien dire que ce mannequin usé, vidé, dont nous n’aurions su voir que les ridicules, nous apparut grâce à lui comme un homme de grande aristocratie et de beaucoup d’esprit. Cependant Marcel, assis de côté, les genoux pliés, nous regardait manger un bon poulet moins bon cependant que ceux que Céleste rôtissait chez lui. On parla voyage… et comme le nom de Constantinople fut prononcé, je me souviens qu’il récita une longue page de Loti. Alors dans l’enthousiasme où m’avait mis ce dîner, cette compagnie, ce que j’entendais, qui excitait ma curiosité au plus haut point, pour lui marquer toute ma sympathie, ma tendresse naissante, je m’émerveillais de sa mémoire et de cette page. Il me regarda d’un air amusé, se tut, mais plus tard, au moment de nous quitter, il me dit, « Lisez l’indicateur Chaix, c’est bien mieux… » et il se mit à me réciter des « noms de pays ».
Ainsi j’avais connu en une fois tous les traits qui composent sa figure : cette taquinerie entêtée, cette bonté masquée, cette autorité généreuse, et cette gentillesse, cette perspicacité qui le rendent inoubliable.
*****